
Résultats

Félicitations à la lauréate de l’édition 2019, Chantal Fleury, pour sa nouvelle On ne les emportera pas au paradis !
— Quoi? dit-il, debout devant le réfrigérateur ouvert. Vous avez pas encore goûté aux chocolats que je vous ai rapportés de voyage?
C’était un de ces premiers beaux jours de printemps et dans la voiture, fenêtres grandes ouvertes, pris d’une soudaine euphorie, il avait eu envie de faire quelque chose de différent, de ne pas rentrer tout de suite à la maison, mais de prendre cette sortie sur l’autoroute qui l’entraînerait hors de la ville. Après avoir roulé quelque temps dans le paysage commercial de la banlieue autoroutière, il s’était retrouvé en pleine campagne, humant avec bonheur les odeurs de la terre fraichement remuée et des floraisons agrestes qui envahissaient la voiture. Enfin, il s’était arrêté et avait téléphoné chez lui pour dire à sa famille de ne pas l'attendre pour souper. Au moment d’interrompre la communication, il avait eu quelques secondes de malaise : vers où se diriger maintenant? Et tant il est vrai qu’il est difficile d’aller sans but, il s’était accroché à la pensée qu’il n’était pas loin du village de son enfance et avait décidé de rendre visite à ses parents.
Il le regrettait déjà.
La petite maison dans laquelle vieillissaient ses parents dégageait dès l’entrée cet éternel fumet de soupe aux légumes mélangé à l’odeur des produits nettoyants. Dès la première bouffée de cet air, son allégresse printanière avait commencé à chuter.
— Mais Martin, des chocolats si rares, on attend une occasion! avait répondu sa mère.
Il avait pris une bière et s’était assis sur un des tabourets de l’îlot de la cuisine, des tabourets encore recouverts d’une housse de plastique, vingt ans après leur achat.
Il revoit sa mère comme il l’avait surprise ce jour-là, ses vêtements d’intérieur protégés d’un tablier usé, ses cheveux teints d'un blond terne, ses joues rondes encore, heureuse et insistant pour le garder à souper, mais se retenant de montrer sa joie, semblant même quelque peu gênée par sa venue, car comme toujours mesurant son plaisir, le diluant dans quelque bouillon de sentiments mêlés, ainsi qu’elle le faisait pour ses soupes, affadissant les légumes frais en y mélangeant les restes amollis du réfrigérateur.
— Ça adonne mal, ton père est allé jouer aux quilles avec ses retraités, il va être déçu de t’avoir manqué! avait-elle dit sur un ton de reproche, glissant une main dans ses cheveux, puis sur son tablier, comme si elle avait voulu redonner de la fraîcheur à sa coiffure et aux couleurs passées de ses vêtements, en les repassant du plat de la main.
Ces reproches, cette sempiternelle retenue maternelle, et l’impression à la fois de propreté domestique et de manque de coquetterie de leur foyer, sorte de laisser-aller bien entretenu, avaient achevé de flétrir sa joie.
— Mais de quoi tu parles, maman, quelle occasion? Je les achetés pour vous! La boîte est même pas ouverte!
— On attendait d’avoir de la visite…
— Mais quelle visite? Vous recevez jamais personne!
Sa mère, qui goûtait la soupe, avait eu un regard blessé et s’était défendue, refermant le couvercle de la casserole :
— Ton oncle vient parfois, et ta sœur. Et puis nos amis, les Leclerc, ils sont venus jouer aux cartes, pas plus tard que samedi dernier!
— Et vous ne leur avez pas offert de chocolats? Il avait exulté un instant de la savoir coincée.
— Ah ben, avait-elle hésité, c’est que… ils ont préféré des chips, il faut dire que ça va mieux avec la bière! Elle avait gloussé. Avec eux, c’est toujours la même chose, avait-elle dit, esquissant un sourire indulgent à la pensée des Leclerc.
Les Leclerc. Toute leur famille au salon funéraire.
— J’comprends pas! J’vous ramène des chocolats faits par un artisan français, des chocolats qui m’ont coûté un bras, excuse, mais c’est comme ça, ils m’ont coûté un bras, et vous, vous les laissez moisir au frigo! Vous les avez même pas déballés!
Et disant cela, il avait posé violemment sa bière sur le comptoir, avait sorti la boîte du réfrigérateur et avait commencé à enlever le papier décoratif qui la recouvrait.
Assis à l’îlot de sa propre cuisine, aujourd’hui, il rougit de honte à ce souvenir.
— Tiens, comme ça vous allez peut-être oser! avait-il dit.
Elle lui avait repris la boîte, le frôlant de ses vieilles mains si douces.
— Donne-moi ça, s’était-elle débattue. C’est nos chocolats maintenant, on les mangera quand on voudra!
— Mais maman! Les chocolats, ça sert à rien de les protéger, comme tes tabourets, les chocolats c’est fait pour le plaisir, on les mange, pi après on a la gourmandise d’autre chose, et la vie continue! Tiens, pourquoi on en mangerait pas un ce soir, pour dessert?
— Ben voyons donc! On va au moins attendre ton père! Puis, avec moins de conviction, ta sœur… Ta femme?
— Avant qu’on soit de nouveau réunis, ça ira pas avant les fêtes, d’ici là ils vont changer de goût, ils s’ront plus bons! Quel gaspillage! avait-il conclu en haussant les épaules.
— Ah? Ça se garde pas?
Il avait souri pour lui-même, content d’avoir réussi à la toucher en faisant appel à son sens de l’épargne. Ébranlée, elle était restée quelques secondes immobile, observant la boîte au papier déchiré. Enfin, elle avait soigneusement terminé de retirer le papier fleuri, l’avait plié puis rangé dans un tiroir où elle gardait cette sorte d'objets au cas où, rubans, élastiques, allumettes, le tiroir dont la découverte des trésors inutiles l’avait amusé un moment, malgré sa tristesse, le jour où il était venu faire le ménage pour préparer la maison à la vente, et elle avait remis la boîte au réfrigérateur en promettant à son fils d’y goûter bientôt.
— Tu as raison mon garçon, on va y goûter avec ton père, on t’en donnera des nouvelles, c’est sûrement des bons chocolats. Sa voix était redevenue douce. On les laissera pas s’perdre, t’en fais pas, avait-elle répété. De toute façon, on les emportera pas au paradis!
Il s’était alors calmé, ne poussant pas plus loin son avantage, se félicitant, en admirant les derniers éclats du soleil par la fenêtre de la cuisine, de ne pas vivre avec cette parcimonie, se promettant pour la millième fois de ne pas vieillir comme eux.
— Tu f’ras ben comme tu voudras m’man, tu as raison après tout, ce sont vos chocolats… J’trouve juste que c’est dommage, comme tout le reste d’ailleurs, comme le fait que vous profitiez pas de votre retraite. Vous êtes jamais allés voir la mer par exemple! Hein? Qu’est-ce que vous attendez? D’être trop vieux?
— Ben justement, avait-elle dit timidement, comme on avoue un secret honteux, on en a parlé avec les Leclerc. On irait peut-être cet été…
Elle avait dressé le couvert sur l’îlot de la cuisine, parce que comme ils n’étaient que tous les deux, ça ne valait pas la peine de salir sa belle nappe. Elle lui avait servi un grand bol de soupe et des biscuits salés qu’elle tartinait de beurre jauni et ramolli, en racontant leur projet de voyage avec les Leclerc, quelques jours à Old Orchard à la Saint-Jean-Baptiste.
Ils ne s’étaient jamais rendus. Pour des raisons non élucidées, leur voiture avait pris le champ. Les Leclerc et son père étaient morts sur le coup. Sa mère avait survécu jusqu’à l’hôpital, mais n’avait pas tenu jusqu’au matin suivant.
Le jour du ménage de la maison désertée, debout devant le réfrigérateur ouvert, tenant dans ses mains un sac-poubelle, il était tombé sur la boîte de chocolat. Il avait soulevé le couvercle. Il en manquait deux. Il avait regardé un instant les deux coupoles de papier doré, vides, écrins d’absence.
Il avait alors imaginé ses parents, la veille de leur départ, comme ils devaient être excités à la pensée de vivre cette grande aventure, apeurés, mais décidés à aller de l’avant et faisant cette folie qui était de rompre l’ordonnance parfaite de la boîte pour y faire deux trous, un à côté de l’autre, et croquer les chocolats qui avaient fondu contre leurs joues. Ils s’étaient regardés en souriant, c’est vrai qu’ils sont bons, puis avaient hésité, et finalement avaient décidé de garder les autres pour après, quand ils reviendraient de voyage. Ça devait avoir quelque chose de rassurant, l’idée du plaisir à venir, l’idée que la boîte serait là à les attendre.
Il n’avait pas eu le cœur de la jeter et l’avait emportée chez lui.
— J’peux m’prendre une bière, pa? Lui demande son fils en faisant irruption derrière lui dans la cuisine. Il n’attend pas la réponse et ouvre le réfrigérateur, maintenant la porte ouverte de son bras replié et se penchant pour fureter, cherchant ce qu’il trouverait bien à grignoter avant le souper.
— Wow la belle boîte de chocolat! s’exclame-t-il en la sortant du réfrigérateur, puis, se souvenant d’où elle vient. T’as encore les chocolats de grand-maman? Il soulève le couvercle… il en manque juste deux. Penses-tu qu’y sont encore bons? J’peux-tu en prendre?
Il est occupé à nettoyer des champignons. Leur odeur de caveau, comme celle qui l’assaillait dans la descente de l’escalier, alors qu’il y faisait des courses pour sa mère quand il était enfant, lui monte aux narines. Son premier élan est de vouloir protéger de la désinvolture de son fils, cette trace des derniers gestes de ses parents vivants. Il hésite, déposant les avant-bras sur le comptoir. Il voudrait dire non, mais il n’ose pas. Ne s’était-il pas interdit les réflexes étriqués de ses géniteurs?
— Ils ne doivent plus être bons, répond-il sans conviction.
Son fils hausse les épaules : « Alors, pourquoi les garder? » Il approche la boîte de son visage.
— Ils sentent encore bon! Avoye! Rappelle-toi qu’ils t’ont coûté un bras!
Et sans attendre l’approbation du père, il s’en jette un goulûment au fond de la gorge, puis un autre, et un autre encore, avec l’appétit de sa jeunesse, pigeant au hasard et hochant la tête de satisfaction. Le père reste muet devant le sacrilège. Enfin, le fils s’ouvre une bière et laisse la boîte de chocolat sur le comptoir, le couvercle renversé, les petites corolles dorées retournées sur elle-même, dans un éparpillement qui fait oublier l’ordonnance première souhaitée par l’artisan.
Et la vie continue, s’oblige-t-il à penser. Il en prend un à son tour et en brise la coquille sans enthousiasme, du bout des dents, puis il s'efforçe d'avaler la pâte doucereuse qui se mêle à l’odeur de la terre et au sel de ses larmes.
Félicitations aux quatre autres finalistes sélectionnés par le jury.
Quand elle a prononcé ses vœux perpétuels à 20 ans, Thérèse Desbiens a pris le nom de sœur Marie-Thérèse de Jésus.
Elle vient d’avoir 70 ans et, aujourd’hui, on l’appelle simplement sœur Marie-Thérèse. Ailleurs, on aurait déjà célébré son départ à la retraite. On ne l’a pas fait pour elle. Ce concept ne s’applique pas ici. D’abord parce qu’on ne cesse pas d’être religieuse, mais surtout parce que, malgré son âge, elle reste l’une des plus jeunes de sa communauté. Tant de consœurs comptent sur elle !
Dans ses jeunes années, sœur Marie-Thérèse enseignait les arts plastiques, en particulier la peinture. Mais, sa communauté avait trop besoin d’elle et lui a demandé de renoncer à sa première passion. On l’a envoyée suivre une formation de base en soins de santé, puis la religieuse est revenue au couvent et a revêtu son tablier de service.
Depuis ce jour, elle consacre la majeure partie de son temps à adoucir les dernières années de ses sœurs. Elle est là à leur réveil et les aide à faire leur toilette, à s’habiller, et pour celles qui le peuvent encore, à se déplacer vers le réfectoire. Surtout, elle prie avec elles et les veille quand leurs dernières forces les abandonnent.
Sœur Marie-Thérèse se donne entièrement à sa mission, dans l’intimité de la prière comme dans celle de la douleur. Chaque jour qu’elle consacre à ses soeurs la rapproche de ces femmes, même de celles pour qui elle n’avait pas ressenti d’affinités jusque-là.
Elle trouve de l’apaisement dans ces moments de partage avec ses compagnes âgées. Doucement, en silence parfois, ou en chantant à d’autres moments, elle masse les vieilles dames pour redonner de la mobilité à leurs membres amaigris. Elle change leurs vêtements souillés et lave délicatement, avec pudeur, leurs parties restées le plus souvent secrètes.
À leur décès, c’est elle encore qui les lave une dernière fois avant de les remettre à l’entreprise funéraire. Parce qu’elle sait que c’est dans un corps digne et propre qu’elles auraient voulu quitter le couvent.
Les soins des malades occupent presque tout son temps. Le peu qu’il lui reste, elle le consacre à la peinture. Seule, dans la paix, elle goute l’harmonie des formes et des couleurs ou leur combat pour la lumière. Elle profite de ces heures de solitude pour décharger son cœur des lourdeurs accumulées pendant la journée.
Quelques toiles de sœur Marie-Thérèse illustrent, c’est incontournable, des thèmes religieux. Toutefois, la majeure partie de sa production représente des scènes de la nature : félins aux aguets, chevaux en course, oiseaux perchés sur une branche. Elle a aussi peint des portraits, mais de loin. Comme si l’intérêt de la peintre se portait davantage sur les paysages que sur les personnages qui en rompent le déploiement.
Cinquante années de vie religieuse méritent d’être soulignées et les amies de sœur Marie-Thérèse ont entrepris de les célébrer en organisant une exposition de ses œuvres. Elles y invitent toutes les communautés religieuses de la région.
Les ecclésiastiques et les membres des clubs de l’âge d’or viennent nombreux à l’exposition tenue au couvent. L’excitation des organisatrices, les éclats de rire et les embrassades détonnent un peu dans ce lieu habituellement consacré aux exercices de piété. Les toiles de la petite sœur artiste suscitent des commentaires bienveillants, fondés au moins autant sur l’amitié qu’on lui porte que sur son talent. Elle reçoit tout de même quelques propositions d’achat.
Cependant, la soeur n’a aucune idée de la valeur commerciale de son travail. Aussi, sœur Solange lui suggère-t-elle de prendre conseil avant de conclure quelque vente que ce soit.
— Mon neveu dirige une galerie d’art. C’est un gentil garçon, je peux l’appeler si vous voulez.
Bertrand Noël est un peu surpris de l’appel de sa vieille tante Solange. Sa demande l’embarrasse, mais il ne parvient pas à la refuser. Ce sera sa bonne action du mois.
Dans l’auto qui le mène au couvent, il est convaincu qu’il s’en va perdre son temps chez les bonnes sœurs. Au moins, il est content de revoir sa tante. Pour le reste, plus vite ce sera expédié, mieux ce sera. Les premiers tableaux confirment ses préjugés. La thématique est religieuse, la signature est celle d’une nonne; inutile d’essayer de vendre ça.
Pourtant, il stoppe net devant les peintures animalières. Il y voit à la fois la précision de la représentation, la justesse des couleurs et le raffinement de leurs nuances. Les passages subtils de la lumière aux ombres sont impressionnants. Oui, il y a une peintre ici.
— D’accord, je vois une niche pour votre travail. Mais je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Ce ne sera pas le marché des collectionneurs. Par contre, je connais des amateurs pour ces représentations hyperréalistes.
Si vous aviez aussi d’autres tableaux, des œuvres moins figuratives, par exemple, j’aimerais bien les voir.
Marie-Thérèse rougit. Son embarras n’échappe pas à ses consœurs toujours à l’écoute. Cependant, elles ont la délicatesse de se tenir à l’écart.
— J’ai bien quelques toiles, mais rien qui puisse être vendu. C’est ma collection privée.
Bertrand Noël n’insiste pas. Il emprunte quelques tableaux. Au cours des semaines suivantes, il enregistre de belles ventes et revient souvent au couvent. Avec le temps, la confiance s’enracine suffisamment entre eux pour que Marie-Thérèse consente à lui montrer sa collection privée.
— Mais, je vous le répète : ces tableaux ne sont pas à vendre.
Dans l’atelier, elle ouvre d’abord un placard, puis déplace quelques toiles et même des boites vides. Tout au fond, entre les chevalets, recouverts d’un drap, elle extirpe, comme si elle les exhumait, onze tableaux étonnants.
Ce sont des nus. Pas des nus de jeunes femmes au corps splendide. Non! Les corps peints sont décharnés, osseux, prostrés. Sœur Marie-Thérèse a fidèlement représenté les femmes qu’elle a lavées et changées.
Pas de sang, pas de cris ni de grimaces. Seulement la faiblesse et la fatigue qui s’étalent. Les yeux creux des malades sont déjà éteints. Leurs cheveux aplatis confirment que leur corps n’a pu être déplacé depuis des jours. Les bouches entrouvertes, les lèvres pendantes que les muscles atrophiés ne parviennent plus à soutenir, la peau flasque et cireuse de chacune, fine comme un parchemin pour certaines, tout cela confirme qu’il ne reste que très peu de vie en elles. Plusieurs paraissent si vulnérables et effrayées que Bertrand Noël se retient de parler pour ne pas les brusquer.
Toutes sont à la lisière de la vie et de la mort. Certaines viennent même de franchir la ligne. Elles sont peintes sur le dos, les mains pudiquement croisées sur le pubis, les yeux fermés. Seules celles-là ne semblent pas souffrir.
Bertrand Noël est fasciné. Il passe d’un tableau à l’autre, puis revient au premier. Il ne peut s’en détourner. En chacun, il y a une beauté qui touche à l’horreur. En tous, il discerne une tragédie lente et inexorable.
Sur ces toiles, il retrouve la minutie et le réalisme des peintures animalières de la religieuse. Toutefois, ces corps souffrants, à l’extrême limite de leur vie, ont une puissance encore plus grande. Ils font mal.
La peintre le sort de sa contemplation. Elle n’a pas encore parlé depuis qu’elle a dévoilé ses tableaux secrets.
— J’ai peint ces femmes pour effacer leurs dernières heures de mon esprit. Je ne garde en moi que leurs moments de bonheur.
— Ce sont des personnes réelles? Je veux dire… ce sont des personnes que vous connaissez?
— Que je connaissais! Elles sont toutes mortes maintenant. Je ne les aurais jamais peintes ainsi de leur vivant.
Ces femmes mortes habitaient encore le cœur de la peintre. C’est leur dernière heure qu’elle a reproduite sur la toile. Bertrand Noël sait d’instinct qu’une exposition de ces tableaux toucherait un public de choix. Plus que des amateurs à la recherche de décoratif, ils attireraient des collectionneurs et des représentants de musées. Mais le marchand ne se fait pas d’illusions. Sœur Marie-Thérèse n’est pas prête.
— Je n’oserais jamais exposer ces tableaux, ce serait trop embarrassant pour mes consœurs. Elles m’ont accueillie dans leur intimité. Or, l’intimité est un privilège rare qui ne se partage qu’avec parcimonie.
Il ne servirait à rien d’insister. Bertrand Noël n’essaie même pas. Il comprend que, pour Marie-Thérèse, ces onze tableaux constituent un chemin de croix encore inachevé.
— Vous avez souffert avec ces femmes, on le sent. Et vous les avez aimées, ça se voit.
Elle sourit, un sourire à peine esquissé, mélancolique.
— Il y a, dans ces tableaux, des femmes pour lesquelles j’ai éprouvé du désir. Mais sans rompre mes vœux. On dit éprouver du désir, car c’est bien ce qu’est le désir : une épreuve.
Le galeriste admire encore chaque toile. Quel dommage !
— Peut-être, un jour, pourrez-vous consentir à les montrer au public ? Puis-je l’espérer, au moins?
— Quand nous serons toutes mortes… peut-être.
Puis, avec un long soupir, elle lui fait comprendre que son exploration est terminée.
Lors des visites suivantes, il arrive que l’artiste permette au marchand d’explorer à nouveau son placard secret. Quand il tente de la convaincre de lui céder au moins un tableau, elle s’amuse de son enthousiasme et de ses compliments. Chaque fois, elle le remercie, mais lui répète que ces tableaux-là resteront cachés. Puis, avec un sourire malicieux, elle lui glisse :
— Cher Bertrand, je suis honteuse. Malgré mon âge, vous parvenez encore à raviver mon orgueil. Et vous soufflez sur de vieilles braises que j’ai mis des années à éteindre.
La collection privée de la peintre continue à s’enrichir pendant quelques années, jusqu’à ce qu’elle soit, à son tour, étendue dans son lit, émaciée, à la lisière de la vie et de la mort.
Outre les vieilles religieuses, seul Bertrand Noël assiste à ses funérailles.
Quelques semaines plus tard, il reçoit une caisse contenant plusieurs tableaux et une note manuscrite. Marie-Thérèse lui demande de ne pas dévoiler l’origine de ces toiles ni le contexte dans lequel elles ont été réalisées.
— S’il vous plait, vous verserez les montants obtenus de la vente de ces œuvres à ma communauté. Elle est en grand besoin.
Sa collection secrète comprend maintenant quatorze tableaux. Du nombre, treize représentent des mourantes. Le dernier surprend Bertrand Noël. Il s’y reconnait. Debout, nu, jambes écartées. Et, à la place du pénis, un cierge allumé remonte jusqu’au milieu de son abdomen.
L’exposition attire autant les amateurs que les professionnels. Malgré les prix élevés qu’il en demande, les treize tableaux signés Thérèse Desbiens sont vendus en quelques jours.
Quant au quatorzième, Bertrand Noël le garde. Il verse à la communauté le meilleur prix qu’elle ait reçu pour une œuvre de leur consœur.
Pour la première fois, il est gêné en regardant un nu.
Aujourd’hui encore, il se demande quelle vision animait Thérèse lorsqu’elle a peint ce cierge allumé. Et il réentend son amie : « On dit éprouver du désir, car c’est bien ce qu’est le désir : une épreuve. »
J’ai tenté à plusieurs reprises de lui pardonner. Je suis allée me confesser auprès du Père Josef, j’ai demandé à Dieu de me délivrer de mon péché mortel, de m’apporter la paix mais à chaque fois que je le voyais dans la ruelle avec les voyous qu’il appelle ses amis, assis sur des vieilles chaises de bois à boire de la bière cheap et à fumer des cigarettes, le cri de Mia-Lyne retentissait à nouveau dans ma tête et me transperçait le cœur. Pourquoi Notre Seigneur a-t-il rappelé à lui ma douce Anna pour nous laisser ce bon-à-rien en échange ?
Quand mon mari, Leon, m’a convaincu de prendre un navire et quitter la Pologne pour s’installer au Canada, j’ai cru à ses promesses de grands espaces verts et d’une nation accueillante et pacifique. Lorsque que nous sommes débarqués à Montréal, au Quai 21, sans le sous et affamés, un jeune prêtre, polonais aussi, nous a demandé de le suivre. Accompagnés d’une dizaine d’autres familles qui voulaient aussi immigrer au Canada, nous l’avons suivi jusqu’à un vieil hangar. Une section dortoir avait été aménagée avec de vieux matelas posés à même le sol. Au fond, à droite, il y avait une cuisine rudimentaire où des religieuses s’affairaient à préparer une soupe aux légumes dans une grosse marmite posée sur un poêle chauffé au bois.
C’est le jeune prêtre qui nous a aidé à trouver un logement à prix modique et qui a obtenu un job pour Leon au chantier naval Canadian Vickers. Même en vivant modestement et en tentant d’économiser, le faible salaire de mon mari n’a jamais réussit à nous procurer le capital nécessaire pour s’acheter une terre agricole comme nous l’avions rêvé en traversant l’Atlantique.
Il m’a fallu beaucoup de temps pour m’adapter à mon nouveau pays. Montréal est très différente de mon village natal. Si je restais à proximité de mon logement de l’Avenue Gascon et que je fermais les yeux, je pouvais presque me transporter chez nous. J’entendais les voisines mémérer dans ma langue maternelle, j’allais à la messe tous les dimanches où le Père Josef nous sermonnait en polonais. La petite épicerie, au coin de la rue, offrait des produits de mon pays et le samedi après-midi, les odeurs de kielbasa à l’ail qui fumaient dans les cours arrières du quartier faisaient gargouiller mon ventre arrondi. Mais j'avais peur de m’aventurer hors des limites de La Petite Pologne car je ne me sentais pas bienvenue.
C’est pour cela d’ailleurs que lorsque son père est décédé d’un infarctus, trente ans plus tard, j’ai refusé l'offre d’Anna, qui voulait que j’emménage avec elle, son mari Deryck et leur petite fille Mia-Lyne. Je savais que ma fille se souciait de mon bien-être mais sa grande maison en briques de Westmount et les belles voisines riches m’intimidaient.
― J’aime mieux rester dans mes vieilles affaires. Et qui va s’occuper de Mme Buczek si je pars ? Ce n’est pas son fils, ça c’est sûr ! Ne t’inquiète pas pour moi. Je suis bien dans mon petit quartier polonais.
Je me berçais sur mon balcon en buvant une tasse de thé quand Anna et sa petite famille sont sortis de la voiture. C’était mon anniversaire et nous avions prévu aller manger chez Batori. Leurs saucisses sont délicieuses et le gâteau aux pommes est divin. J’ai salué ma petite-fille de la main et elle poussa un cri de joie en me voyant.
― Bonne fête Mamie Eva !
J’étais tellement contente de leur visite. Mia-Lyne ressemble beaucoup à sa mère. Elle a les grands yeux verts de son père mais la bouche, la forme du nez, les expressions faciales sont pareilles à celles d’Anna. Je déposai ma tasse chaude sur la petite table d’appoint et j'ouvris les bras pour accueillir ma petite-fille, qui je savais, viendrait se blottir contre moi.
― Regarde bien des deux côtés de la rue, Mia, lui ai-je dit, en souriant.
Mon sourire se changea en grimace d’horreur quand je vis Mia-Lyne traverser la rue en courant alors que le véhicule de Fillip, le fils de Madame Buczek, s’engagea dans notre rue en roulant trop vite. Ivre, il perdit le contrôle de sa grosse voiture et frappa de plein fouet mon gendre et ma fille. Mia-Lyne, montée de justesse sur le trottoir, se retourna au ralenti et lâcha un cri de mort en voyant les corps de ses parents, ensanglantés et inertes. Je voulus courir vers elle, pour l’éloigner de la scène horrible mais mes jambes refusèrent de bouger. En état de choc, j’étais figé dans mon siège.
Une voisine appela la police qui fut suivi d’un ambulance. Le décès de Deryck fut constaté sur place et ils transportèrent Anna à l’hôpital. Malgré tous les efforts du médecin de l’urgence, Anna succomba à ses blessures mortelles. C’est dans la salle d’attente, tandis que le médecin m’expliqua les procédures tentées pour sauver ma fille et qu’il me débita ses plates excuses, que la douleur intolérable se transforma en une rancœur froide et calculatrice. Tout en berçant ma petite-fille, qui pleurait doucement sur mon épaule, je pris la décision de l’emmener chez moi et de l’installer dans l’ancienne chambre à coucher d’Anna.
Après quelques semaines de cohabitation, une routine confortable s’installa entre nous. Mia-Lyne étant une enfant calme et peu dérangeante, il fut facile pour moi de réapprendre à vivre avec une autre personne. Je n’aimais pas la voir toujours seule par contre. Lorsqu’elle s’enfermait dans sa chambre pour lire ou dessiner, je l’encourageais à aller jouer dehors avec les voisins mais l’aura mélancolique qui l’enveloppait en permanence tenait à l'écart les autres enfants du quartier et par la fenêtre de la cuisine, je la voyais lancer des petits cailloux sur la poubelle de plastique. C’est pourquoi, le jour de ses 10 ans, je l’emmenai à la SPCA afin qu’elle se choisisse un compagnon à quatre pattes.
Je crus que j’allais devoir faire le tour du refuge trois ou quatre fois mais Mia-Lyne s’arrêta devant la sixième cage et s’agenouilla pour flatter le jeune chien noir et blanc. La fiche accrochée à un barreau de l’enclos présentait un berger croisé, mâle, 5 mois, actif, bon avec les enfants de plus de 10 ans.
― C’est lui que je veux, m’annonça-t-elle.
Je tentai de la convaincre de regarder dans les autres cages avant de prendre une décision mais ce fut peine perdue. La frimousse sympathique du chiot avec sa tache noir autour de l’œil droit conquit ma petite-fille.
― Quel nom vas-tu lui donner, demanda la technicienne vétérinaire ?
― Zabo, répondit Mia.
― Zabo? Ce n’est pas commun. Pourquoi Zabo?
― Parce que ça lui va bien.
Le matin je marchais avec Mia-Lyne jusqu’à l’école puis je prenais la laisse de Zabo pour le ramener à la maison. Les vendredis je m’arrêtais en chemin, à l’épicerie Varsovie, pour acheter des saucissons et j’en mettais quelques-uns de côté pour Zabo. Pendant que Mia était à l’école, je me chargeai de l’éducation de base du chien mais c’est Mia qui lui apprit à faire toutes sortes de trucs, à l’aide de bouts de saucissons. Je me félicitai régulièrement de ma décision d’adopter un chien pour Mia. La complicité qui se développa entre les deux me réchauffait le coeur et faisait sourire quiconque les voyait ensemble.
Fillip fut libéré de prison après seulement 6 mois de détention grâce à sa bonne conduite. D’un commun accord silencieux, nous fîmes notre possible pour éviter de se croiser. Sa gang et lui changèrent de ruelle pour flâner et draguer. Il prit l’habitude de sortir de la maison avant que j’arrive pour prendre soin de sa mère et je quittais par la porte de derrière lorsque je l’entendais revenir. Mia-Lyne me comprit pas pourquoi je continuais à faire le ménage, à préparer la nourriture de Madame Buczek et à m’assurer qu’elle était confortable. J’eus beau lui dire que la pauvre n’était pas responsable du crime de son fils et que c’était le seul revenu que j’avais pour nous faire vivre, un air de reproche planait souvent sur son visage lorsque je rentrais à la maison.
J’emmenais souvent Zabo avec moi. Maintenant âgé de 6 ans, il pouvait rester allongé calmement pendant que ma cliente le caressait. Elle semblait moins souffrir lorsque Zabo lui tenait compagnie et le chien appréciait les marques d’affection de la vieille dame. Cela me permettait de terminer mes tâches plus rapidement. Parfois, j’avais même le temps de lui faire la lecture. Elle affectionnait particulièrement Gustaw Herling alors que pour moi, ses écrits sont d’un ennui mortel.
Un après-midi d’octobre, inhabituellement doux, je m’assis sur la berceuse installée sur le balcon arrière avec une tasse de thé et regardai Zabo jouer dans les feuilles mortes. Madame Buczek faisait la sieste et je profitai d’une pause. Lorsque Fillip entra dans la cours arrière j’arrêtai de me bercer. Je m’interrogeais sur son arrivée prématurée qui m’emmerdait royalement. Zabo grogna en direction de Fillip qui tenta de lui asséner un coup de pied.
― Je vous ai dit plus d’une fois de ne pas venir chez nous avec votre bâtard de chien !
Au même moment, la porte du jardin s’ouvrit et Mia appela son chien.
― Au pied, Zabo !
Puis, en le caressant affectueusement, le félicita.
― Bon chien, Zabo, dit-elle, en lui donnant un bout de saucisse.
― Décidément ! C’est un après-midi plein de surprises ! Que fais-tu ici Mia, demandai-je ?
Depuis qu’elle a emménagé chez moi, Mia-Lyne a toujours refusé de venir à la maison de Madame Buczek. Elle ne voulait même pas s’en approcher et pour éviter de passer devant la façade, nous devions faire un détour quand nous marchions ensemble. Le calme froid et l’énergie mortelle qui se dégageait de ma petite-fille me glacèrent le sang.
― Je suis venue venger la mort de mes parents.
Mia-Lyne se releva lentement. Droite comme un soldat, elle lança un regard dur rempli de haine vers Fillip. L’homme, se balançant d’une jambe à l’autre, sembla incertain et nerveux. La main de Mia cessa de caresser la tête de Zabo et d’une voix ferme mais étrangement touchante elle donna l’ordre à son chien.
― Atak ! Zabójczy !
D’un bond, Zabo sauta sur Fillip et lui mordit le cou. Fillip essaya de se défendre et de repousser la bête mais le chien ne lâcha pas prise malgré les coups de poing qu’il reçut dans les flancs. Après ce qui me sembla un temps interminable, le chien abandonna la dépouille sanguinolente et retourna vers sa maîtresse.
Horrifiée, je repassai dans ma tête, la scène qui venait de se dérouler sous mes yeux. J’eus du mal à assimiler ce qui venait de se passer mais je compris finalement le nom que Mia avait choisi pour son complice. C’est un diminutif de zabójczy qui en polonais veut dire assassin… ou mortel, selon le contexte.
Autoroute 15 nord, la sortie approche.
Machinalement je mets mon clignotant et décélère un peu.
Il me faudra sortir mes affaires de la voiture, entrer chez moi, maladroite comme à mon habitude, une lanière qui se prend dans la serrure, j’ai l’air vraiment imbécile.
Il me faudra sourire aux enfants, prendre un ton mi- enjoué, mi- fatigué, ne pas interroger leur silence et leur demi-bonsoir.
Il me faudra déposer mon cellulaire sur mon bureau, non, ne pas regarder si la lumière clignote, rebrancher mon ordinateur portable, non, ne pas consulter tout de suite les courriels, m’intéresser aux sites que j’ai mis en marque-pages avant de partir, oui ce tartare de saumon serait parfait pour la soirée du 10.
Ce souper est prévu depuis si longtemps, comment l’annuler… Comment aurais-je la force? Il faudrait que je trouve une excuse valable. Une raison professionnelle. Une réunion imprévue? Trop calculé. Un dossier important à finaliser? Trop convenu. Une collègue qui pète les plombs? Trop vrai. Leur dire que je n’ai plus envie de les voir? Bah alors, ma pauvre chérie, qu’est-ce qu’il se passe? Ton amoureux? Ton travail? Nous?!
Et tout ce que j’aurai à faire d’ici là… Ne pas oublier que M. est allergique au homard, que U. est allergique à M., que F. est en plein épuisement professionnel – non, pas personnel, juste professionnel, que C. ne supporte pas l’odeur de cigare, que J. ne fume plus que des cigares – de toute façon, avec ce qu’il lui reste à vivre, les médecins on s’en fout, non?
Il faudra penser à la musique. Cela fait des siècles que je n’ai pas dansé. Pas le temps, pas l’énergie, pas la dose de folie pour penser que je peux être jolie et désirable et juste moi-même en dansant. JS apportera de la pop italienne et aussi de vieux tubes français qu’on chante à tue-tête quand on est presque ivre. Il faudra qu’une semaine avant le 10, je pense à mettre de l’antirides le matin et le soir, que je perde trois kilos, que je lise le roman de mon collègue que je n’ai pas encore lu malgré tout le bien que je lui en ai déjà dit – il sera là au souper, que je lise aussi les 12 articles que j’ai mis en marque-pages et qui sont in.dis.pen.sables si on veut comprendre où s’en va l’art contemporain. Il faudra que le 10 je pense à me persuader que je suis assez brillante, parce que quand je me crois imbécile c’est ce qui arrive, justement.
Il faudra répondre aux questions intimes posées par mon meilleur ami, oublier d’abord qu’il se fout complètement de mes réponses, puis ne pas l’oublier trop longtemps au risque de le voir réprimer un demi-bâillement, paraitre m’intéresser à ses dernières conquêtes – ah bon? La fille du cinquième? Mais je croyais que tu flashais sur le petit nouveau? Il faudra flageller cette imbécile de K. qui se croit meilleure que tout le monde, s’entendre sur le fait que c’était mieux avant, que le monde va à sa perte et que, somme toute, le pire dans une soirée lavalloise est l’avalanche de clichés sur la vie.
La voiture derrière moi arrive vite dans mon rétroviseur. Ce type veut sûrement sortir lui aussi de l’autoroute. Où va-t-il? Rentre-t-il chez lui ou bien va-t-il rejoindre sa maitresse dans un parc? Ce n’est pas ce qui manque, les parcs, dans ce coin-là.
Finalement il change d’avis et me dépasse. Je tourne la tête, c’est une vielle dame grisonnante, les bras rapprochés du volant et droite comme un i sur son siège. Ils ont le droit de rentrer tard, dans leurs résidences, les vieux? Mais d’où vient-elle?
Il faudra aussi que je prévienne ma voisine qu’il y aura du bruit dehors, le 10. Elle ne sort jamais dans son jardin, mais je préfère prendre les devants. Elle est âgée, gentille mais âgée. La voir me rassure parfois sur le temps qui passe, parfois cela me noue l’estomac.
Il a plu un peu, je ne m’en étais pas rendu compte. Je prendrai rendez-vous avec le garage, mes pneus sont sans doute trop usés. J’imagine le bruit du caoutchouc lisse sur l’asphalte mouillée et cela me fait mal aux dents. Tiens, je croyais que tous les phares désormais étaient blancs. Des phares jaunes? De vieilles lumières du siècle dernier? Peut-être que je me trompe… Je lis machinalement la fameuse phrase du rétroviseur «OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR» et mes yeux ne voient plus qu’elle, l’arrière-plan reste flou.
Je me souviens de quelques images du film de Truffaut, Un homme et une femme. La pluie, la voiture, la classe. C’est fou comme dans un film en noir et blanc, tout devient plus chic. Ce soir sur cette autoroute à quelques minutes de la banlieue, je suis près de Deauville, moi aussi. J’oublie la couleur bleu canard de ma voiture et mes kilos en trop. Je suis Anouk Aimée filant vers Trintignant, oui, le contraire du film, mais c’était il y a plus de cinquante ans, tout de même, on peut bien inverser les souvenirs.
La radio devient complice. Les analyses économiques sur la crise ont fait place à une vieille chanson de Coldplay. Je suis dans un autre film, le générique de fin va bientôt apparaitre sur l’image. Je ne veux pas sortir de ce demi-songe. Je n’arrive pas à sortir le moindre son de ma gorge, je me contente de jouer la musique dans ma tête. Je voudrais que ce temps hors du temps s’étire, mais impossible de mettre sur pause ni d’avancer plus vite. Chaque seconde doit se déguster ou se digérer – chez moi cela passe mal.
L’eau à présent dégouline sur les vitres de la voiture. La pluie a repris de plus belle. Les phares des autres voitures brouillent la noirceur, rien n’est vraiment visible, on discerne à peine quelques formes allongées qui glissent dans la nuit. Au loin je reconnais vaguement la pancarte lumineuse de la publicité du vendeur de piscines. J’avais un spa, dans mon ancienne maison, qu’est-ce que les nouveaux propriétaires en ont fait? Ils l’ont gardé, forcément. Est-ce que leurs enfants jouent dans le jardin, ce beau jardin un peu sauvage où il y avait même un abricotier? Est-ce que cette famille est heureuse? J’aimais l’odeur des fleurs de cerisiers et les vignes au raisin trop acide et les myosotis qui couvraient le fond du jardin.
Mes yeux piquent un peu, les essuie-glace grincent avec monotonie, il fait vraiment sombre et l’autoroute semble s’allonger au milieu du ciel. Stairway to heaven. Drôle de drame pour drôle de temps. Et drôle de réflexe que de baisser le son de la radio quand on cherche sa route ou qu’on ralentit. Alors je tourne le bouton vers la droite, un peu plus fort, oui, contre toute attente, plus fort et plus vite. Mon pied enfonce la pédale de l’accélérateur, je donne un léger coup de volant vers la gauche, je déborde des limites de la bretelle de sortie, la pluie est plus forte, les lumières plus aveuglantes, mon cœur bat plus vite.
Je m’exhume de ma vie. Je ne reviendrai pas.
Entrez, entrez! Votre visite me fait plaisir. Allons au salon, voulez-vous?
Ne prêtez pas attention aux grincements; il s’agit de mon climatiseur. Il n’a pas cinq ans, mais il se dirige déjà vers la tombe. Il agonise. Une maladie incurable : selon le réparateur venu la semaine passée, les pièces de rechange de mon modèle sont discontinuées. J’espère simplement que le bidule ne mourra pas avant l’automne, quand l’air, dehors, redeviendra tolérable. Sinon, les autorités devront m’ajouter aux statistiques sur les victimes de la canicule. Avec ma pension de misère, je parviens à peine à payer mon loyer et l’électricité. Acheter un climatiseur neuf en plein été, quand ils coûtent encore plus chers que d’habitude? Pour une petite vieille comme moi : impossible.
Pouvez-vous croire qu’autrefois, été rimait avec vacances, joie et légèreté? On riait, on jouait, on vivait. Aujourd’hui, on ne pense plus qu’insolation, rationnement d’eau, et, bien sûr, climatiseur.
Excusez cet accueil grincheux, je vous en prie. Ces étés trop chauds me rendent nostalgique. C’est toujours au plus fort de la canicule que je m’ennuie de la neige, du froid, du blanc partout… Un vrai hiver, entendons-nous, pas les catastrophes verglacées que nous connaissons aujourd’hui. De nos jours, il pleut, ça glace et ça recommence comme ça à chaque semaine, sans répit, de décembre à mars : pas un hiver, un calvaire. Hier matin, j’ai réalisé que je n’ai pas vu un seul flocon depuis près de trente ans. Ça m’a donné un coup au cœur : les Noëls blancs n’existent plus depuis une génération complète. Il faut monter loin vers l’arctique, maintenant, pour apercevoir un mince tapis blanc, mais le voyage coûte très cher et seuls les riches et les politiciens peuvent se le permettre. Moi, je dois me contenter de mes souvenirs.
Vous-même, avez-vous déjà vu de la neige? Non? Je m’en doutais. Vous me paraissiez bien jeune, aussi.
Asseyez-vous à côté de moi, là. Votre compagnie apporte un peu de changement à ma routine estivale. D’ordinaire, je reste cloîtrée dans ma petite maison et je passe mes journées à lire et à regarder dehors, comme une prisonnière. Ce que je suis, si on réfléchit bien : avec la canicule pour geôlière, je ne peux rien faire d’autre. Puisque la télévision et la tablette émettent de la chaleur, je préfère les garder fermées, sauf trente minutes le soir, pour les informations. Heureusement, ces rideaux diaphanes me permettent de voir dehors tout en conservant l’intérieur à l’ombre. Alors autant en profiter.
Regardez-moi ce paysage… Un tableau, presque. Je le titrerais « Fièvre planétaire ». Qu’en pensez-vous? Morbide, peut-être, mais à propos : après des siècles d’infection, le système immunitaire de cette bonne vieille Terre se réveille et chasse le virus humain.
Admirez comment les symptômes se manifestent partout, implacables et silencieux. Dans l’air, pour commencer : ce ciel bleu, troublé et terne. Le nuage de pollution nous étouffe lentement et rien ne pourra y remédier. Regardez par terre, ensuite. Le bitume si chaud qu’il semble mouillé. Les pelouses brûlées aux brins jaunes cassants. Les arbustes gris, secs, sans fleur ni feuille. Les rares averses estivales ne parviennent pas à étancher la soif de la terre : lorsqu’il pleut, l’eau s’abat en trombes avec trop de violence pour être absorbée par le sol. Tout ruisselle dans les égouts et déborde dans les sous-sols.
Ces pelouses et ces arbustes constituent l’évidence la plus visible, mais on l’évacue comme toutes les autres : en faisant diversion, en l’ignorant. Dans les beaux quartiers, plus personne ne couvre son terrain de gazon. On installe désormais des rocailles coûteuses, avec des statues artistiques et des cailloux décoratifs. Ils appellent ça la mode, mais je n’y vois qu’un aveu de défaite supplémentaire. Voyez : même l’érable, en face, a rendu les armes cette année. Tout tordu et crevassé, avec ses branches défeuillées qui ressemblent à des serres tendues vers le ciel, on dirait un monument funéraire.
Fièvre planétaire, je vous le dis. La Terre se débarrasse de nous, une canicule à la fois.
Je vois que vous cillez. Mon cynisme vous choque-t-il? Mon âge me porte à oublier l’optimisme inhérent à la jeunesse. Je sais que plusieurs affirment que tout ne meurt pas, que certaines choses changent, simplement, et qu’il faut nous adapter. Ils n’ont pas tort. Et pourtant… Tenez, par exemple, des plantes existent et prospèrent encore. Mais la plupart sont vénéneuses. Venues du sud, elles envahissent nos plates-bandes nordiques avec la vigueur des conquérants et prolifèrent plus vites que les pissenlits de mon enfance. L’une d’elles a élu domicile dans ma cour. Une grande plante aux petites fleurs blanches en forme d’ombrelle. Magnifique… et absolument toxique. Une herbe à puces sur les stéroïdes. Je ne peux pas m’en approcher, encore moins désherber : le moindre effleurement brûle et crée des cloques sur la peau. À moins d’appeler un spécialiste – et je n’en ai pas les moyens – elle est là pour rester. Je calcule que, d’ici quelques étés, elle occupera le terrain jusqu’au patio et m’empêchera de sortir.
Et ces nouvelles plantes ne migrent pas seules. De nouveaux insectes les accompagnent pour faire leur nid dans nos contrées. La remarquez-vous, là, dans l’ombre de sa toile, près de la fenêtre? Toute noire avec une tache rouge sur son ventre rebondi. Une véritable horreur. J’ai hurlé lorsque j’ai trouvé ma première veuve noire dans le jardin, il y a vingt ans. J’ignorais alors qu’elle n’était que le début…
J’espère que je ne vous ennuie pas? Non? Vous possédez la patience d’un ange. Voudriez-vous me donner le verre d’eau, là, sur la table de chevet?
Ah! Pardonnez ma grimace. Cette eau possède un goût infect, mais bon, le rationnement ne permet pas de faire la fine bouche. Tant qu’elle est potable, on se compte chanceux. Saviez-vous qu’au début du siècle, dans mon enfance, nos politiciens acceptaient de vendre nos sources à des entreprises privées? Leur cupidité force maintenant la province à acheter de l’eau à un prix exorbitant. De l’eau qui coule sur notre propre territoire! Si l’enfer existe, j’espère que ces ripoux y crèvent de soif pour l’éternité.
Je… Oh, voyez-vous ça, une ambulance s’amène, gyrophares allumés. Qui exécute des embardées inutiles. Un petit nouveau au volant, sans doute, paniqué par son premier appel. Heureusement pour lui, les trottoirs et les rues, ici, restent déserts à la journée longue durant l’été. Personne, dans le coin, ne possède la santé de fer requise pour s’aventurer dehors en plein jour, comme vous.
Ne rougissez pas : c’est un compliment. Les gens comme vous, en santé et prêts à aider son prochain, se raréfient à chaque année. Tout le monde devient de plus en plus malade. De plus en plus égoïste. Bientôt, plus personne ne prendra la peine de visiter les vieilles grincheuses comme moi. Même le livreur ne cogne plus. Depuis l’automne passé, il se contente de déposer l’épicerie hebdomadaire à la porte, et jamais à la même heure. À nous de la récupérer avant qu’elle ne se gâte. La productivité avant tout. Je comprends, mais les deux ou trois phrases que nous échangions me manquent. Et pas qu’à moi : les premières semaines de ce régime, Sophie, ma voisine de gauche, a protesté. Mais c’est un peu de sa faute, aussi. Ce garçon se montrait trop poli pour lui dire qu’il ne pouvait pas rester à l’écouter radoter. Une fois, elle l’a retenu une heure entière, le pauvre petit.
Ah, tiens, l’ambulance s’arrête… ici? Allons donc. Vous permettez? Je vais tirer le rideau – une fois n’est pas coutume. Je veux savoir qui est mort. Et puis, l’allure des ambulanciers m’amusent, encapsulés dans leurs combinaisons étanches. On dirait presque des astronautes. Vous en avez déjà vu – des ambulanciers, je veux dire? Non? Approchez, alors. Regardez-les. Casque, gants, bottes, bonbonne, tout le bataclan. Ils doivent crever de chaleur là-dessous, malgré la climatisation intégrée. Mais aussi ridicule soit-il, leur costume est nécessaire : les corps se décomposent très vite, l’été, et ils boursouflent. Sans parler des insectes qui accompagnent les cadavres… asticots, mouches, coquerelles. Un métier répugnant que celui d’ambulancier, de nos jours.
Un blessé au lieu d’un mort, dites-vous? Non, je ne crois pas. Les gyrophares, souvenez-vous. Dans ce secteur, les vivants ne suscitent aucun empressement chez le personnel médical. La vieillesse et la pauvreté coûtent cher au système et, selon nos savants économistes, elles ne rapportent rien. Un mort, par contre, transforme la situation en urgence sanitaire. Là, ils se dépêchent à venir, une fois alertés. Par le livreur, la plupart du temps. Il repère facilement les décès. Une semaine de provisions qui pourrissent devant la porte, c’est difficile à manquer.
Hum! On dirait bien qu’ils se rendent chez Sophie. Pauvre vieille. Nous nous connaissions depuis longtemps. Aussitôt que le mercure tombait sous la barre des trente degrés, nous sortions et, assises sur nos perrons respectifs, nous nous racontions nos souvenirs, nos petits bobos, les dernières nouvelles. Avec elle partie, je reste tout fin seule. Une chance que les services sociaux offrent encore des visites à domicile.
Vous vous agitez, soudainement. Le temps est écoulé, n’est-ce pas? Je parle sans arrêt dès que j’ai un auditoire; je n’y peux rien. Alors n’hésitez jamais à m’interrompre. Reviendrez-vous la semaine prochaine? Même jour? Excellent. Je…
Non, oubliez ça, finalement. Annulez ce rendez-vous. Et faites-moi plaisir, évitez de repasser par ici dans les prochains jours.
Pourquoi?
N’entendez-vous pas le silence? Mon climatiseur vient de rendre l’âme.
Prix

Plongez dans votre rêve d'écriture et courez la chance de vivre une expérience créative hors du commun!
Inscriptions : du 6 mai au 2 juin 2019
Critères
- N’avoir jamais publié d’œuvre de fiction
- Être citoyen ou résident permanent du Canada
- Être âgé de 18 ans ou plus
- Soumettre une nouvelle inédite de 1200 à 1800 mots s’inspirant du thème : MORTELS
À gagner : une semaine (9 jours) de retraite créative, toutes dépenses payées, en compagnie d’auteurs et de créateurs chevronnés, ainsi que la publication, au terme d’un accompagnement éditorial, d’une nouvelle dans le recueil Les Disparus d'Ély publié aux Éditions Québec Amérique. La retraite d’écriture se tiendra à la résidence B-12 de Valcourt en Estrie, en septembre 2019.
Thème
La nouvelle doit obligatoirement être inspirée du thème imposé, soit MORTELS.
Nous n'imposons aucune contrainte quant au genre littéraire ni au style d'écriture.
Règlements
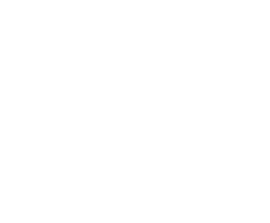

- Les textes soumis doivent être rédigés en français;
- Les candidats garantissent qu’ils sont les auteurs du texte soumis;
- Chaque candidat ne peut soumettre qu’un seul texte;
- Tous les textes doivent être soumis via le formulaire en ligne du Prix;
- Tous les textes doivent être soumis de façon anonyme : le nom du participant ne doit pas figurer sur l’œuvre ni dans le nom du fichier électronique, afin d’assurer l’objectivité du jury;
- Tous les textes doivent être présentés sous forme électronique en format Word ou Wordpad (.doc, .rtf ou .docx) dans un document de format lettre (8 ½ po sur 11 po);
- Tous les textes doivent être présentés à double interligne, et ce, dans une police et une taille de caractères lisibles;
- Toute soumission est définitive. Aucun changement ni substitution n’est possible;
- Le gagnant doit être disponible du 15 au 23 septembre 2019 pour la retraite d’écriture;
- Le gagnant doit pouvoir se rendre par ses propres moyens à Montréal, là où il sera pris en charge;
- Le prix devra être accepté tel quel, et ne pourra être échangé ou transféré. Aucune substitution ne sera permise;
- Le gagnant doit consentir à être filmé et photographié lors de la retraite créative, ainsi qu’à collaborer aux activités de promotion de l’événement;
-
Les concurrents, en participant à ce concours :
- acceptent de se conformer à ces règles générales sous peine de disqualification.
- accordent au Groupe Québec Amérique une licence non exclusive l’autorisant à reproduire le texte soumis et à le publier en tout ou en partie sur les sites et plateformes qu’il contrôle;
- Le lauréat s’engage à signer un contrat d’édition pour le texte à paraître dans le recueil ainsi qu’à accepter le travail de direction littéraire, de révision et de correction d’épreuves que l’éditeur estimera nécessaire, dans le respect de l’œuvre;
- Le Groupe Québec Amérique se réserve la possibilité de publier le texte gagnant du concours et/ou le texte rédigé lors de la résidence dans son recueil de nouvelles;
- Les employés du Groupe Québec Amérique ne sont pas admissibles.
Évaluation
Les textes soumis sont jugés de façon anonyme, en fonction de la qualité et de l’originalité de la langue, du respect de la forme (nouvelle) et du style. Une première sélection est faite par le comité éditorial des Éditions Québec Amérique, puis le texte gagnant est déterminé par un jury composé de trois personnalités littéraires choisies par le Groupe Québec Amérique.






