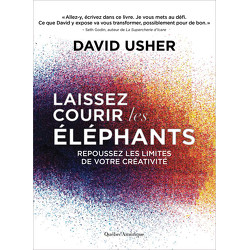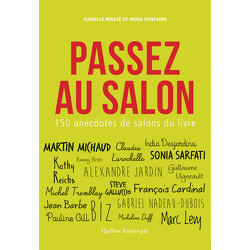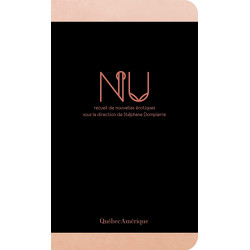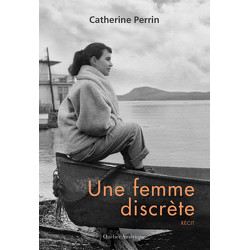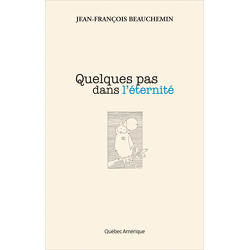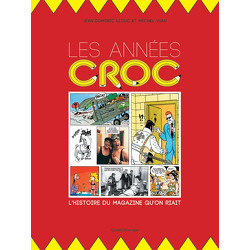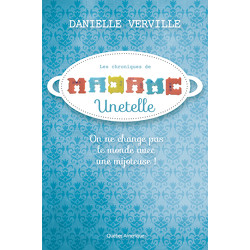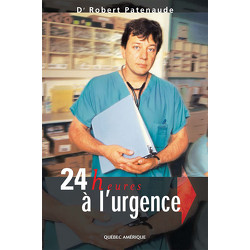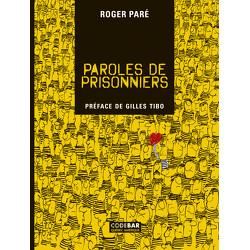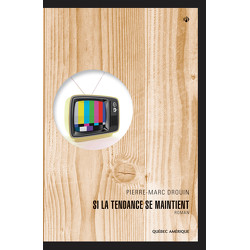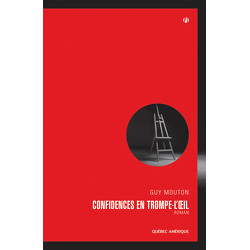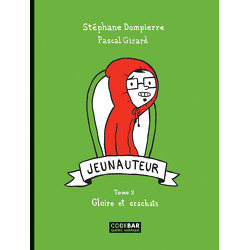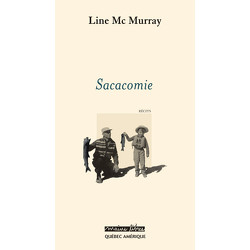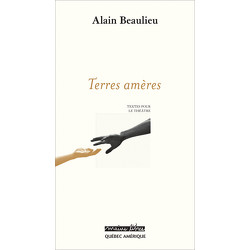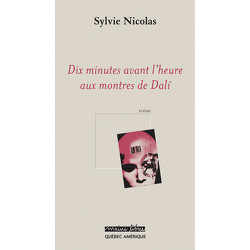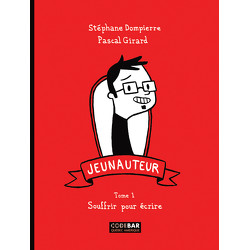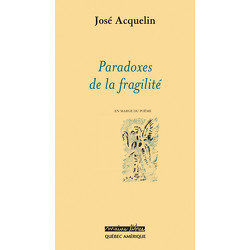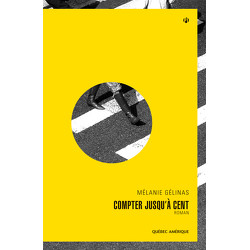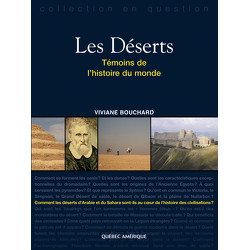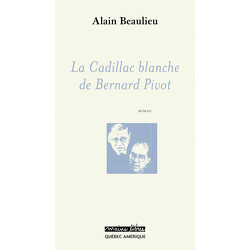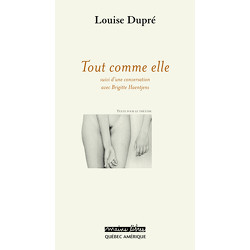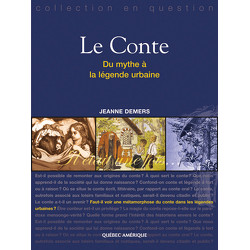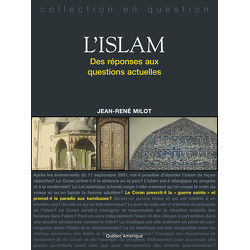Résumé
Ce que toute personne devrait savoir de l’économie d’aujourd’hui
Ce livre, destiné aux observateurs intéressés - non nécessairement spécialistes - du domaine de l’économie et des affaires, est un peu comme une fresque esquissée à grands traits. Il oppose les anciennes méthodes de gestion à celles qui émergent. Mais d’abord et avant tout, il cherche à expliquer l’ancien ordre économique et ce, afin de mieux faire ressortir le nouvel ordre et de décrire ses lignes de force.
J’ai cherché à faire oeuvre de synthèse en pressant le citron au maximum. D’abord pour être bref, mais surtout pour transmettre l’essentiel.
Mes anciens collègues universitaires voudront bien me pardonner certains raccourcis pris à l’égard de l’histoire, des théories, des écoles de pensée. J’ai préféré établir des liens entre les différents éléments plutôt que de les décrire en détail. J’ai voulu aller au coeur du sujet sans embrouiller le lecteur avec des précisions, des nuances qui, d’ailleurs, n’auraient rien ajouté ni changé à la trame. Aux spécialistes, je suggère d’examiner le tableau dans son étendue. En fait, c’est aux non-spécialistes que j’ai pensé en cherchant à rendre le produit non seulement accessible, comestible et digestible, mais propre à stimuler l’appétit. J’espère avoir réussi.
Il faut avant tout remercier Jean-Paul Lejeune qui a recueilli mes propos et qui leur a donné leur première forme. Sa patience, sa ténacité et surtout sa capacité d’écoute pour orienter certaines recherches, fournir des exemples et réorganiser le texte ont été un atout précieux.
J’ai profité des remarques et observations de plusieurs personnes dont Michel Bélanger, Reuven Brenner, Jean-Paul Caron, Marcel Côté, Gérard Coulombe, Jeau-Claude Gagnon, Luce Gosselin, Pierre Lemieux, Dominique Vachon et, de l’École des HEC, Jacques Fortin, François Leroux, Michel Patry ainsi qu’Alain Chanlat qui a favorisé l’éclosion - le choc parfois - de certaines des idées qu’on retrouve dans ce livre. À tous, j’exprime ma vive reconnaissance.
Enfin, cet ouvrage est publié parce que les idées ont été éprouvées au creuset de l’action dont André Bérard a été le professeur le plus éloquent et le plus convaincant.
Léon Courville

Léon Courville a été directeur de l’Institut d’économie appliquée à l’École des Hautes Études Commerciales, et...
Léon Courville a été directeur de l’Institut d’économie appliquée à l’École des Hautes Études Commerciales, et économiste en chef de la Banque...
Léon Courville a été directeur de l’Institut d’économie appliquée à l’École des Hautes Études Commerciales, et économiste en chef de la Banque nationale du Canada pour enfin...
Léon Courville a été directeur de l’Institut d’économie appliquée à l’École des Hautes Études Commerciales, et économiste en chef de la Banque nationale du Canada pour enfin en devenir le chef des opérations. Il partage actuellement son temps entre son vignoble et les conseils d’administration auxquels il participe.
Léon Courville a été directeur de l’Institut d’économie appliquée à l’École des Hautes Études Commerciales, et économiste en chef de la Banque nationale du Canada pour enfin en devenir le chef des opérations. Il partage actuellement son temps entre son vignoble et les conseils d’administration auxquels il participe.
Léon Courville a été directeur de l’Institut d’économie appliquée à l’École des Hautes Études Commerciales, et économiste en chef de la Banque nationale du Canada pour enfin en devenir le chef des opérations. Il partage actuellement son temps entre son vignoble et les conseils d’administration auxquels il participe.
Chapitre 1
Retour à l’anarchie
Croissance des marchés, stabilité politique, enrichissement des populations ont favorisé l’apparition de nos entreprises hiérarchisées et planificatrices. Mais la concurrence mondiale, l’incertitude politique, l’arrêt de la croissance poussent ces organisations à rétablir la symbiose entre elles et le nouvel environnement chaotique pour lequel elles n’ont pas été faites.
Qu’il était doux de gérer une entreprise en 1970! Les gestionnaires se pressaient aux conférences comme celle organisée par l’Institut de contrôle de la gestion, à Paris, sous le thème Comment maîtriser sa croissance? À cette époque, pas si lointaine, les économistes nous parlaient d’une société de loisirs, dans laquelle nous consommerions encore plus que dans la société de consommation. Et tout ça avant l’an 2000, avec en prime la semaine de travail de vingt heures! Le monde, enfin stabilisé politiquement et socialement, profiterait des bienfaits d’entreprises de biens et services mondiales, organisées, automatisées qui seraient en mesure de prévoir très exactement tous nos besoins. À cette fin, elles n’auraient qu’à mettre en application des méthodes de gestion et à lancer des programmes de planification infaillibles. On nous promettait une sorte de meilleur des mondes sans surprise, sans crise, sans incertitude.
Mais aujourd’hui, le rêve s’est envolé: c’est la décroissance qui est au rendez-vous. La société des loisirs n’a jamais vu le jour. Quant à la société de consommation, ce symbole de la victoire du matérialisme occidental, fini: plus personne n’en parle. Elle était pourtant considérée comme le pur fruit du système capitaliste. Les marchés se nourrissaient de la société de consommation et elle-même alimentait les marchés en y injectant toujours plus d’argent. Dans un contexte de croissance économique sans fin, le but de l’existence même était de consommer, et l’objet des entreprises, de produire toujours plus.
Une civilisation de moutons
Il y a vingt, quarante ans, le petit monde des industriels et des marchands ne se faisait pas de mauvais sang: tout semblait si facile à vendre. L’argent venait tout seul, fruit de la croissance, ou par la magie de l’emprunt: les gouvernements se mirent à hypothéquer l’avenir, libérant les individus de l’obligation d’y penser eux-mêmes. La richesse collective semblait promise à une croissance infinie. Assurés que l’acheteur achèterait, nous n’étions pas obligés de nous montrer très créatifs. Pendant longtemps, les consommateurs durent se contenter d’une unique sorte de cola, d’un seul type de chaussures, de voitures Ford exclusivement noires, entre autres choses.
Les techniques de vente étaient basées sur des modèles: nous montrions aux clients ce qu’ils devaient acheter. Et ils achetaient, car dans une société qui a de l’argent, celui qui n’en a pas est suspect. Chacun doit montrer qu’il dépense comme son groupe social. Avec des consommateurs aux goûts prévisibles, conformistes et qui ont de l’argent, il était aisé de prévoir ce qu’il fallait produire, en quelle quantité et à quel prix. Les gestionnaires vivaient en symbiose parfaite avec leur environnement économique, politique et social.
Cependant, dans les années 70, la spirale consommation-croissance, croissance-consommation s’est rompue, du moins au sens où on l’entendait. L’ère de l’opulence (The Affluent Society) de John Kenneth Galbraith commençait à laisser voir des fissures inattendues. Une rupture s’amorçait et la production de biens ne donnait pas les résultats escomptés. Comme l’économie ne tirait plus, les gouvernements se mettaient à utiliser la planche à billets pour pousser la corde de la croissance, en oubliant qu’il est vain de pousser une corde. Les déficits structurels des gouvernements venaient de voir le jour. Le généticien français Albert Jacquard a peut-être raison quand il décrit la génération moderne comme la plus voleuse (à l’égard des générations futures) de l’histoire. Certes, le progrès économique continue, mais une bonne partie n’était qu’un leurre et nous ne l’avons pas vu tout de suite.