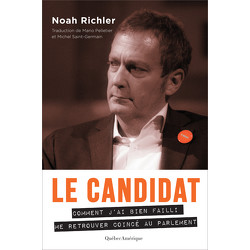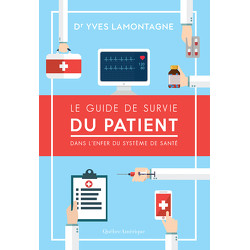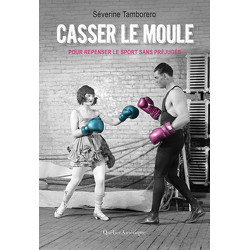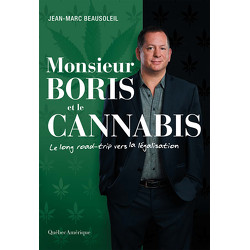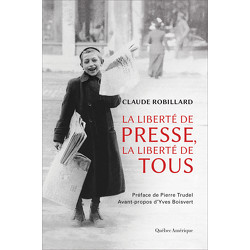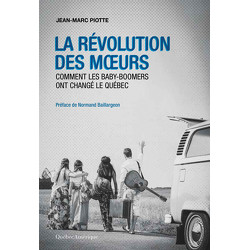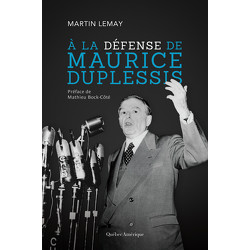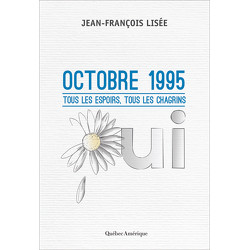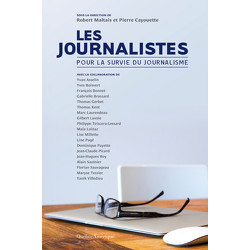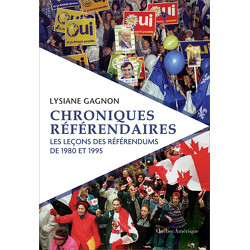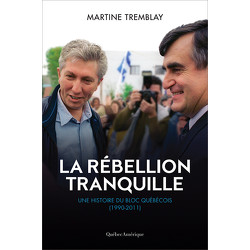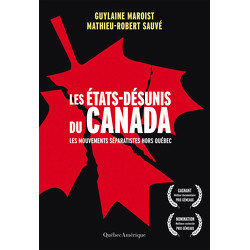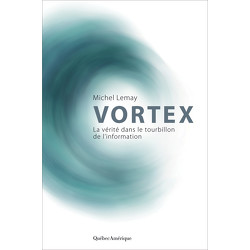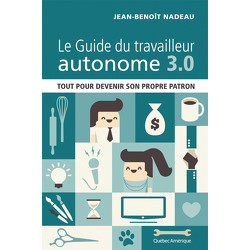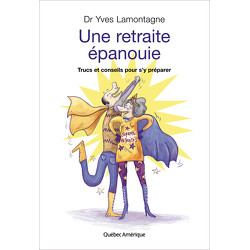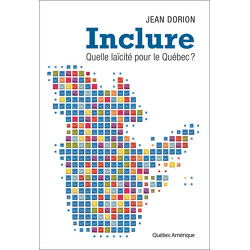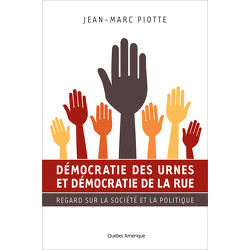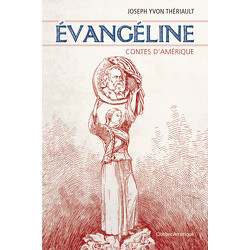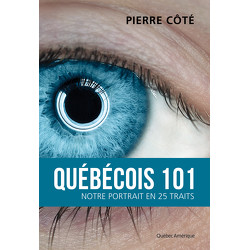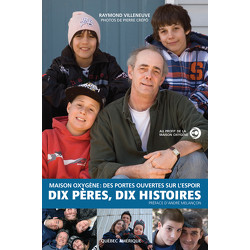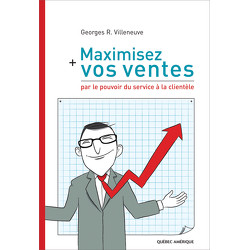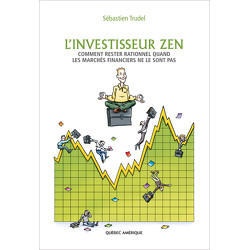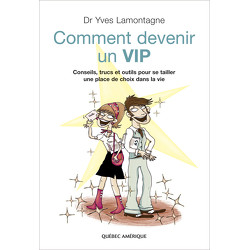Résumé
• La première traduction du célèbre livre de Joseph Schull.
• Une chronique passionnante de la révolte des Patriotes.
• Rébellion expose avec lucidité et précision les causes et les conséquences de ces événements incontournables de notre histoire collective.
En 1837, on a d’abord cru que le Canada français venait d’amorcer une véritable insurrection contre ses maîtres britanniques. Pourtant, la rébellion des Patriotes, dans plusieurs villages de la vallée du Richelieu et à Saint-Eustache, ne sera suivie que d’une tentative avortée de libération, en 1838.
Quelles étaient les véritables causes d’un tel mécontentement?
En 1759, la Nouvelle-France est conquise par la force; les Français sont défaits. Trente ans plus tard, près de 90 % de la population demeurait malgré tout francophone et catholique.
Loyaux à l’Angleterre malgré la Révolution américaine, et combattant les envahisseurs américains en 1812, certains Canadiens français ont tout de même pris les armes contre leurs gouvernants anglais.
Non seulement les vagues successives d’immigration anglaise avaient nettement pour but d’assimiler les Canadiens français, les politiques gouvernementales les écartaient du monde des affaires et des postes politiques importants. Même l’éloquence d’un Louis-Joseph Papineau n’arriverait pas à mettre fin aux injustices.
Rébellion de Joseph Schull constitue une passionnante chronique de cette imprévisible «levée d’armes».
D’abord publié en 1971, Rébellion ne se satisfait pas de retracer les causes de la colère du Canada français; ce livre démontre à quel point cette page tragique et mémorable de notre histoire a peut-être paradoxalement été, à sa façon, à l’origine de ce «partenariat» qui a construit le Canada.
Joseph Schull

Joseph Schull a grandi en Saskatchewan, mais a surtout vécu au Québec. Il fut à la fois l’un des écrivains et des...
Joseph Schull a grandi en Saskatchewan, mais a surtout vécu au Québec. Il fut à la fois l’un des écrivains et des historiens canadiens les plus...
Joseph Schull a grandi en Saskatchewan, mais a surtout vécu au Québec. Il fut à la fois l’un des écrivains et des historiens canadiens les plus respectés. Dramaturge et essayiste, il...
Joseph Schull a grandi en Saskatchewan, mais a surtout vécu au Québec. Il fut à la fois l’un des écrivains et des historiens canadiens les plus respectés. Dramaturge et essayiste, il est aussi l’auteur d’une biographie unanimement célébrée sur Wilfrid Laurier.
Joseph Schull a grandi en Saskatchewan, mais a surtout vécu au Québec. Il fut à la fois l’un des écrivains et des historiens canadiens les plus respectés. Dramaturge et essayiste, il est aussi l’auteur d’une biographie unanimement célébrée sur Wilfrid Laurier.
Joseph Schull a grandi en Saskatchewan, mais a surtout vécu au Québec. Il fut à la fois l’un des écrivains et des historiens canadiens les plus respectés. Dramaturge et essayiste, il est aussi l’auteur d’une biographie unanimement célébrée sur Wilfrid Laurier.
À Hélène, Christiane,
Joseph et Michael,
Canadiens et Québécois
Chapitre 1
La Conquête inachevée
Au début du XIXe siècle, les fonctionnaires du Colonial Office à Londres trouvaient sans doute que le problème du Canada était des plus ennuyeux. Apparu au moment de la Conquête, à la bataille des plaines d’Abraham, il était arrivé en Angleterre avec les restes de Wolfe. Il hantait la politique britannique depuis ce jour, car dans toutes ses composantes il rappelait de façon lancinante à quel point les nobles espoirs et les plans les mieux préparés avaient lamentablement échoué. À chaque échec il se faisait plus épineux, augmentant la perplexité du gouvernement impérial et empêtrant les hommes d’État qui ne l’abordaient qu’à contrecoeur.
Grâce à la victoire de Wolfe, confirmée par le traité de Paris en 1763, la Grande-Bretagne écarta la France pour enfin devenir seul possesseur de tout le continent nord-américain. Elle réussit ainsi à lever la menace qui pesait sur ses Treize colonies. Le continent entier s’ouvrait maintenant aux deux millions d’Anglais confinés jusque-là sur une étroite bande de terre, bordée au nord par la vallée du Saint-Laurent et à l’ouest par une vaste contrée dont les Français contrôlaient les voies navigables. Il semblait donc qu’un grand empire était sur le point de prendre forme. «Dans un siècle, écrivit Benjamin Franklin, ce digne citoyen de Philadelphie, tout le pays qui s’étend du Saint-Laurent au Mississippi sera peuplé de Britanniques. La Grande-Bretagne elle-même verra sa population augmenter considérablement par suite de la croissance phénoménale de son commerce. Vos navires parcourront tout l’Atlantique et grâce à votre puissance navale, toujours plus considérable, votre influence rayonnera sur tout le globe et étonnera le monde1.»
Cette vision transcendante ne tenait pas compte du problème posé par l’existence du peuple conquis. Comme la Nouvelle-France n’existait plus, on n’avait plus à craindre le pouvoir politique et militaire de la France. Les hauts fonctionnaires avaient tous décampé. Les riches marchands en avaient fait autant, de même que les plus grands des anciens seigneurs qui avaient longtemps vécu dans une semi-noblesse sur des terres concédées à des fins de colonisation par les rois de France. N’étaient restés que les moins fortunés de chaque classe, ainsi que l’Église omniprésente, presque aussi pauvre que ses ouailles. Environ huit mille personnes habitaient les ruines de Québec et cinq mille autres dans la grisaille des pierres calcaires de Montréal. Ces deux villes abritaient tout ce qui restait des élites décapitées et épuisées par la guerre, de la vie professionnelle et commerciale de la colonie, de ses talents, de ses connaissances et de ses métiers. Pour le reste, tout au long de cette succession irrégulière de seigneuries qui occupaient les deux rives du Saint-Laurent, de sa jonction avec la rivière des Outaouais jusqu’à la Gaspésie, il y avait les clochers d’églises et leurs curés, des fermes établies sur des terres ingrates et des forêts, où vivaient quelque cinquante mille paysans catholiques d’expression française.
C’était un peuple joyeux, réticent à faire la guerre, mais qui combattait, lorsqu’il le fallait, beaucoup plus vaillamment que les troupes régulières françaises. D’une frugalité toute normande, il s’accrochait résolument à la terre, bien que, pour les habitants de la colonie, elle n’eût pas été la première passion. Explorateurs, commerçants et aventuriers, ils avaient suivi les grands cours d’eau du continent, vers le nord jusqu’à la baie d’Hudson, vers l’ouest jusqu’aux Rocheuses et vers le sud jusqu’au golfe du Mexique. Leurs fortifications, leurs peuplements, leurs comptoirs et leurs missions – érigés pour faire la guerre, la traite des fourrures et propager la foi – se voulaient l’ébauche d’une civilisation millénaire. Près de dix mille d’entre eux restaient dispersés dans ces avant-postes. Mais maintenant ils ne comptaient plus. Ils s’assimileraient aux Anglais ou aux Amérindiens, ou reviendraient vivre dans les fermes de la vallée du Saint-Laurent, où était leur seule patrie. Seuls comptaient alors les Canadiens regroupés sur les deux rives du Saint-Laurent, qui n’avaient connu qu’une seule forme de gouvernement: la monarchie française. Tous leurs dirigeants étaient partis, sauf quelques prêtres et quelques seigneurs. Ils étaient tous pratiquement analphabètes. Dans une ou deux générations, il était certain que l’assimilation ferait d’eux des Anglais et des protestants, et qu’ils s’intégreraient à l’empire nord-américain.